
J'ai croisé Laurent Herrou une première et une deuxième fois chez Eléments de langage, son futur éditeur bruxellois, et pour la troisième j'ai eu envie d'en découvrir davantage et l'ai invité à me rejoindre à La Porteuse d'eau, une jolie brasserie Art nouveau à St Gilles.
Et là j'ai découvert un écrivain, un vrai ! Auteur d'une douzaine d'ouvrages qui vont du récit de voyage au roman (le premier chez Balland), en passant par ce qui a fait sa marque de fabrique : le journal intime. Là j'ai découvert un homme qui écrivait, mais aussi un homme qui lisait (énormément !), un homme qui pensait (idem), un homme qui organisait, vivait, vibrait ! Un homme aussi juste dans ses évocations et ses passions que dans son écriture même.
Je vous invite à me suivre au fil de cette bonne quinzaine de questions, lors desquelles il nous révèlera qui il est, ce qu'il pense, et quels sont ses projets...
Laurent, comment es-tu entré en écriture, et pourquoi ?
 C’est joli, « entrer en écriture ». Comme on entre dans les ordres. Il y a clairement un engagement dans cette discipline.
C’est joli, « entrer en écriture ». Comme on entre dans les ordres. Il y a clairement un engagement dans cette discipline.
Et une foi. Il y a aussi mille façons de répondre à cette première question, chère Edith, mille anecdotes qui ont été dites ici ou là — le premier travail d’écriture, le premier désir d’écrivain, la première reconnaissance (certaines de ces anecdotes présentes dans Les Bonheurs). Il y a des temps d’entrée différents, suivant que l’on se trouve dans le texte ou dans une maison d’édition. Je crois que je suis entré dans une histoire, au fil de mes lectures, des films que je regardais, des héroïnes (surtout) que j’y rencontrais. Et que j’ai compris très vite qu’à défaut de la vivre, je pouvais lier mon existence à celles que je rencontrais ailleurs, et composer avec les mots quelque chose qui me ressemblerait davantage que le reflet dans le miroir.
Tu as une écriture que je trouve éminemment tendue, et juste, oh combien, avec des particularités comme la rupture (fort intéressante) d’une phrase par deux points, des phrases débutant sans majuscule, des paragraphes se terminant sans point. As-tu toujours écrit ainsi, de manière spontanée, ou bien est-ce le fruit d’un travail et d’une lente évolution de ton écriture ?
 Je suis très sensible à cette remarque. Parce qu’un écrivain, c’est véritablement un style, une manière de s’approprier ce qui appartient à tous : le langage. Mon écriture a bien sûr évolué avec les différentes publications, elle s’est affirmée, radicalisée parfois. Mais dès le départ, j’étais sensible à l’idée d’un rythme, d’une syncope, d’une cassure nécessaire, de répétitions assumées. Tu parles des deux points, il y a aussi le tiret (et Jacques Flament, mon éditeur, râlerait parce que je n’utilise pas le bon, du moins : celui qui, dans le bon usage de la langue, doit être utilisé comme je l’utilise) : j’ai besoin de briser les phrases, suivant le rythme de ma pensée, les interrogations qui me viennent, les pauses mentales que je fais de manière inconsciente lorsque j’écris. Les mots sur la page sont une cartographie précise des rythmes de la pensée, ils en sont une illustration, comme les mesures sur la portée pour un musicien. Je suis sensible, au-delà de ce qui est lu, à la forme, esthétique, du texte, sur la page. L’absence de majuscules, de ponctuation parfois, les retours à la ligne, contribuent à cela.
Je suis très sensible à cette remarque. Parce qu’un écrivain, c’est véritablement un style, une manière de s’approprier ce qui appartient à tous : le langage. Mon écriture a bien sûr évolué avec les différentes publications, elle s’est affirmée, radicalisée parfois. Mais dès le départ, j’étais sensible à l’idée d’un rythme, d’une syncope, d’une cassure nécessaire, de répétitions assumées. Tu parles des deux points, il y a aussi le tiret (et Jacques Flament, mon éditeur, râlerait parce que je n’utilise pas le bon, du moins : celui qui, dans le bon usage de la langue, doit être utilisé comme je l’utilise) : j’ai besoin de briser les phrases, suivant le rythme de ma pensée, les interrogations qui me viennent, les pauses mentales que je fais de manière inconsciente lorsque j’écris. Les mots sur la page sont une cartographie précise des rythmes de la pensée, ils en sont une illustration, comme les mesures sur la portée pour un musicien. Je suis sensible, au-delà de ce qui est lu, à la forme, esthétique, du texte, sur la page. L’absence de majuscules, de ponctuation parfois, les retours à la ligne, contribuent à cela.
Laurent, parle-nous un peu de ce fameux journal (2015, 2016 et bientôt 2017) que tu publies chez Jacques Flament, au départ à la demande ton éditeur, à fois sur le Net et en version papier ?
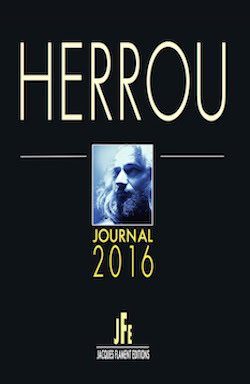 Flament a proposé en 2015 à quatre de ceux qu’il appelle « ses auteurs historiques » de publier leur journal en ligne, sur son site. Il voulait y proposer un espace de création libre, qu’il avait appelé Le labo. L’idée, c’était tout au long de l’année 2015, d’écrire au quotidien, au rythme que l’on voulait, avec une contrainte (plus ou moins respectée) de nombres de signes. La proposition comprenait la publication, l’année suivante, de ces textes dans leur intégralité, sous le titre de Journal 2015 (commun aux quatre auteurs).
Flament a proposé en 2015 à quatre de ceux qu’il appelle « ses auteurs historiques » de publier leur journal en ligne, sur son site. Il voulait y proposer un espace de création libre, qu’il avait appelé Le labo. L’idée, c’était tout au long de l’année 2015, d’écrire au quotidien, au rythme que l’on voulait, avec une contrainte (plus ou moins respectée) de nombres de signes. La proposition comprenait la publication, l’année suivante, de ces textes dans leur intégralité, sous le titre de Journal 2015 (commun aux quatre auteurs).
Quatre livres sont parus début 2016, dont en effet mon Journal 2015.
L’année suivante, Flament nous a proposé de poursuivre nos Journaux, mais sans passer cette fois par la publication en ligne, somme toute très contraignante, à la fois pour lui et pour les auteurs, dans la mesure où elle impliquait un retravail quasi-quotidien de la matière du journal (en tout cas en ce qui me concerne) avant de l’envoyer vers le site. Nous sommes deux à avoir repris le flambeau, Alain Callès et moi-même. Flament a en parallèle ouvert la possibilité du Journal 2016 à deux autres de ses auteurs (Alexandra Bitouzet, dont j’ai préfacé le très beau travail, et Thierry Radière).
Pour moi qui travaille le journal depuis de longues années, c’est important qu’il y ait un suivi : j’ai demandé à Flament, malgré son désir de faire une pause dans son aventure éditoriale l’an prochain, s’il acceptait malgré tout de publier le Journal 2017. Il a accepté, en dépit de ventes bien inférieures à ce que lui comme moi pouvions espérer. Cette confiance fait de lui, à mes yeux, un éditeur hors pair.
Pour toi, « toute vie est un roman », ce qui explique peut-être la facilité avec laquelle tu t’es lancé dans l’entreprise, qui moi ne me semble pas évidente ?
 La question en effet que l’on reçoit le plus, en tant que diariste, c’est celle de l’intérêt pour le grand public de sa vie quotidienne. Qu’est-ce que je vis de particulier qui me fait penser que ça va intéresser le lecteur ? Dans l’entretien que j’ai donné à Arnaud Genon en 2016, suite à la parution du Journal 2015, j’expliquais que la vie de chacun était matière à « roman » (le terme est à mettre entre guillemets) sous réserve que l’information soit traitée avec un minimum de style et de talent dans la forme donnée à son récit. Parce qu’il n’y a pas de « vie particulière » (sinon dans certains moments de l’Histoire, avec un grand H) : nous avons vraisemblablement tous la même. C’est ce terrain commun, ce partage de l’expérience humaine, qui fait selon moi l’intérêt et l’universalité de l’autofiction. « Je est un autre », écrivait Rimbaud. Moi je pense que « Je est tu ». Que le je soit autofictionnel ou romanesque. C’est dans l’identification — et aussi dans l’opposition à cette identification, qui est le même processus, en négatif — que le « roman » fonctionne.
La question en effet que l’on reçoit le plus, en tant que diariste, c’est celle de l’intérêt pour le grand public de sa vie quotidienne. Qu’est-ce que je vis de particulier qui me fait penser que ça va intéresser le lecteur ? Dans l’entretien que j’ai donné à Arnaud Genon en 2016, suite à la parution du Journal 2015, j’expliquais que la vie de chacun était matière à « roman » (le terme est à mettre entre guillemets) sous réserve que l’information soit traitée avec un minimum de style et de talent dans la forme donnée à son récit. Parce qu’il n’y a pas de « vie particulière » (sinon dans certains moments de l’Histoire, avec un grand H) : nous avons vraisemblablement tous la même. C’est ce terrain commun, ce partage de l’expérience humaine, qui fait selon moi l’intérêt et l’universalité de l’autofiction. « Je est un autre », écrivait Rimbaud. Moi je pense que « Je est tu ». Que le je soit autofictionnel ou romanesque. C’est dans l’identification — et aussi dans l’opposition à cette identification, qui est le même processus, en négatif — que le « roman » fonctionne.
Comment (re)travailles-tu le réel pour lui donner la forme du journal ?
Il y a souvent une anecdote comme point de départ de l’entrée du jour : quelque chose que j’ai fait, vu, entendu, lu, partagé. Il me faut une phrase d’entrée pour pouvoir lancer la machine. A partir de ce point de départ, de cette accroche, je déroule le fil. Soit que j’aille jusqu’au bout de l’anecdote, soit que je la tisse avec d’autres éléments qui résonnent avec elle au fur et à mesure de l’écriture — c’est de ces points de rupture-là dont je parlais plus tôt. En général, le processus se fait de lui-même, c’est une écriture instinctive, qui bute parfois sur un terme qui me manque mais coule relativement bien la majeure partie du temps. Le journal est présent dans l’écriture dans la mesure où l’anecdote est contextualisée — chaque entrée est datée — mais il est plus largement un livre, un texte plutôt, dans la mesure où les éléments qui le composent renvoient sans cesse les uns aux autres.
partagé. Il me faut une phrase d’entrée pour pouvoir lancer la machine. A partir de ce point de départ, de cette accroche, je déroule le fil. Soit que j’aille jusqu’au bout de l’anecdote, soit que je la tisse avec d’autres éléments qui résonnent avec elle au fur et à mesure de l’écriture — c’est de ces points de rupture-là dont je parlais plus tôt. En général, le processus se fait de lui-même, c’est une écriture instinctive, qui bute parfois sur un terme qui me manque mais coule relativement bien la majeure partie du temps. Le journal est présent dans l’écriture dans la mesure où l’anecdote est contextualisée — chaque entrée est datée — mais il est plus largement un livre, un texte plutôt, dans la mesure où les éléments qui le composent renvoient sans cesse les uns aux autres.
Voilà pour ce qui est du travail.
Retravailler (puisque tu fais la différence, et généralement : en vue de la publication), c’est faire en sorte que l’on ne se perde pas dans ces éléments. C’est les hiérarchiser d’une certaine façon, c’est choisir parmi eux, ceux qui resteront à termes pour que le Journal (et la majuscule s’impose alors) se tienne d’un bout à l’autre de ses pages.
Lors de notre interview, tu m’as dit que tu n’utilisais dans le journal que 20 % de ta vie. Tu la réinventes, ou l’essentiel est « vrai » (aussi illusoire que soit ce terme), aussi minime soit-il ?
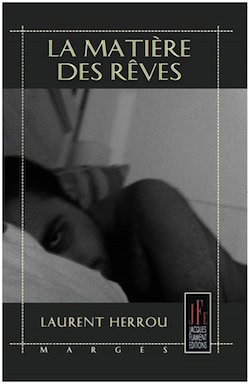 Oui, il fallait imaginer un pourcentage qui rendrait compte du temps passé, à la fois dans l’écriture et dans les événements auxquels l’écriture quotidienne renvoie : 20% est une moyenne. Certains jours, j’écris beaucoup, et le journal est un refuge, un compagnon, un lieu de vie ; certains autres, j’écris une phrase, deux, ou je garde un mail par exemple à la place de l’entrée du jour, et le pourcentage est moindre. Ce que je voulais dire, c’est que ma vie réelle, ma vie vivante, dépasse celle qui est consignée dans le journal. J’allais écrire, et ça aurait été juste : dépasse « la vie de celui qui écrit dans le journal ». Ce qui répondrait en même temps à ta question : bien sûr, tout est vrai pour le Laurent Herrou contenu dans les pages du journal. Celui qui vit à l’extérieur, celui qui vit autour du journal, et de l’écriture, celui qui vit, je, est un autre.
Oui, il fallait imaginer un pourcentage qui rendrait compte du temps passé, à la fois dans l’écriture et dans les événements auxquels l’écriture quotidienne renvoie : 20% est une moyenne. Certains jours, j’écris beaucoup, et le journal est un refuge, un compagnon, un lieu de vie ; certains autres, j’écris une phrase, deux, ou je garde un mail par exemple à la place de l’entrée du jour, et le pourcentage est moindre. Ce que je voulais dire, c’est que ma vie réelle, ma vie vivante, dépasse celle qui est consignée dans le journal. J’allais écrire, et ça aurait été juste : dépasse « la vie de celui qui écrit dans le journal ». Ce qui répondrait en même temps à ta question : bien sûr, tout est vrai pour le Laurent Herrou contenu dans les pages du journal. Celui qui vit à l’extérieur, celui qui vit autour du journal, et de l’écriture, celui qui vit, je, est un autre.
Sachant à quel point le milieu éditorial est saturé, encouragerais-tu un jeune auteur à se lancer dans l’autofiction ?
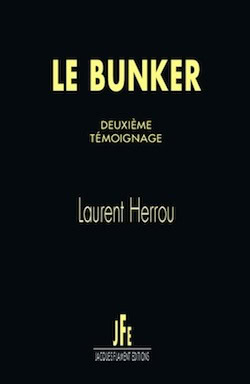 Je ne crois pas en la saturation d’un quelconque milieu que ce soit. Je crois qu’il y a des écrivains et des mots qui ont besoin d’être écrits, et des pages qui ont pour vocation d’être lues. Je crois aussi que beaucoup d’éditeurs publient des livres auxquels ils ne croient pas, pour des dizaines de raisons plus ou moins justifiées et / ou justifiables.
Je ne crois pas en la saturation d’un quelconque milieu que ce soit. Je crois qu’il y a des écrivains et des mots qui ont besoin d’être écrits, et des pages qui ont pour vocation d’être lues. Je crois aussi que beaucoup d’éditeurs publient des livres auxquels ils ne croient pas, pour des dizaines de raisons plus ou moins justifiées et / ou justifiables.
Personnellement, je n’encouragerais personne : ce n’est pas mon travail. C’est celui d’un éditeur qui discernerait un talent potentiel, c’est celui d’un lecteur, d’un ami, qui aimerait, qui soutiendrait. Pas d’un écrivain. Mais je ne découragerais pas non plus, pour reprendre ton expression, « un jeune auteur qui se lance dans l’autofiction ». En tout cas pas pour la raison que tu donnes. Et même si je ne pense pas que l’on se lance dans une telle écriture : on y est ou on n’y est pas. Ce n’est pas une question de choix.
Es-tu un auteur uniquement autofictif, d’ailleurs ?

Pour moi c’est difficile de répondre à ça. Je suis un auteur, j’écris des textes qui, comme je l’ai dit plus haut, répondent à une dynamique qui est juste pour moi. Des lecteurs, des critiques, des écrivains m’ont placé dans cette catégorie-là : j’ai regardé autour de moi, qui y vivait, et j’ai trouvé que j’étais en bonne compagnie, en tout cas : une compagnie juste par rapport au travail que j’entends faire. C’est un peu comme entrer dans une boutique de fringues, regarder les gens qui s’y habillent et se dire qu’on a une chance d’être bien dans les vêtements qu’elle propose. J’ai été un auteur Diesel, Kenzo, G-Star Raw, aujourd’hui, parce que je ne gagne pas beaucoup d’argent, je suis plutôt un auteur Delaveine ou Zara, mais peut-être qu’il y a une vérité plus profonde à voir dans le fait d’être devenu ceci après avoir été cela.
Peux-tu commenter cette belle phrase que tu m’as livrée lors de notre entretien : « Ce qui me plaît c’est quand je crois au je (ou au jeu…) » ?
 Je l’ai dit à propos des livres des autres, je crois. Ça s’applique aussi à ma propre écriture. Si je n’entends pas le je qui écrit dans mes livres (qu’il soit au tu, au il, qu’il porte un nom n’a en l’occurrence aucune importance), c’est que j’ai raté quelque chose. On parlait du roman, si je ne me trompe pas : je te disais que je ne croyais pas au je des romanciers français, en comparaison de celui des romanciers anglo-saxons. Dans la fiction, s’entend. J’ai besoin d’un texte incarné. Quand je lis l’autre. J’ai besoin de croire que l’on me dit quelque chose de personnel. Le temps de la lecture du livre, en tout cas. Après, une fois le livre terminé, si le je est fictif, s’il ne s’agissait en effet que d’un jeu littéraire, ce n’est pas grave puisque j’ai marché.
Je l’ai dit à propos des livres des autres, je crois. Ça s’applique aussi à ma propre écriture. Si je n’entends pas le je qui écrit dans mes livres (qu’il soit au tu, au il, qu’il porte un nom n’a en l’occurrence aucune importance), c’est que j’ai raté quelque chose. On parlait du roman, si je ne me trompe pas : je te disais que je ne croyais pas au je des romanciers français, en comparaison de celui des romanciers anglo-saxons. Dans la fiction, s’entend. J’ai besoin d’un texte incarné. Quand je lis l’autre. J’ai besoin de croire que l’on me dit quelque chose de personnel. Le temps de la lecture du livre, en tout cas. Après, une fois le livre terminé, si le je est fictif, s’il ne s’agissait en effet que d’un jeu littéraire, ce n’est pas grave puisque j’ai marché.
Il y a aussi des je autofictionnels auxquels je ne crois pas.
Beaucoup.
Beaucoup, beaucoup.
Et là, le jeu m’amuse beaucoup moins.
As-tu des auteurs fétiches ?
Oui, mais c’est difficile, là encore. Il y a des livres fétiches et des auteurs que j’ai envie d’aimer. Il y a des auteurs que j’aime même si je ne les ai que mal lus, ou pas assez. Il y a des auteurs dont j’aime un seul livre qui justifie à mon sens qu’ils soient des auteurs. Il y en a (peu) dont j’attends la sortie du prochain livre — non —, plutôt : pour lesquels je me réjouis à chaque publication d’un nouveau livre. Je n’attends rien d’eux. Mais ponctuellement, il y a cette surprise-là. Un nouveau livre. De Christine Angot, de Bret Easton Ellis. De Kirsty Gunn. Mais je lis beaucoup, mal, dans tous les sens, quatre livres en même temps pendant des mois et puis plus rien pendant des semaines. Récemment, j’ai repris les Agatha Christie qui me tombaient sous la main. Je m’y suis plongé comme pour une soirée d’hiver, une couette sur les genoux et un feu de cheminée dans la pièce. Ramassé sur moi-même sur un canapé, ou des tas d’oreillers derrière la nuque. La lecture pour moi, c’est ce truc qui vous renvoie à ça, même quand il n’y a ni canapé, ni oreillers, ni feu de cheminée.
Et des modèles en termes d’autofiction ?
Je vais dire Doubrovsky parce qu’il est l’inventeur du terme, le seul à en avoir fait vraiment, puisque c’était sa création. Les autres écrivent, et on les classe dans une catégorie. Moi y compris.

Angot est revenue quelques fois lors de notre échange, et elle revient souvent dans ton journal 2015. Quelles qualités lui trouves-tu ?
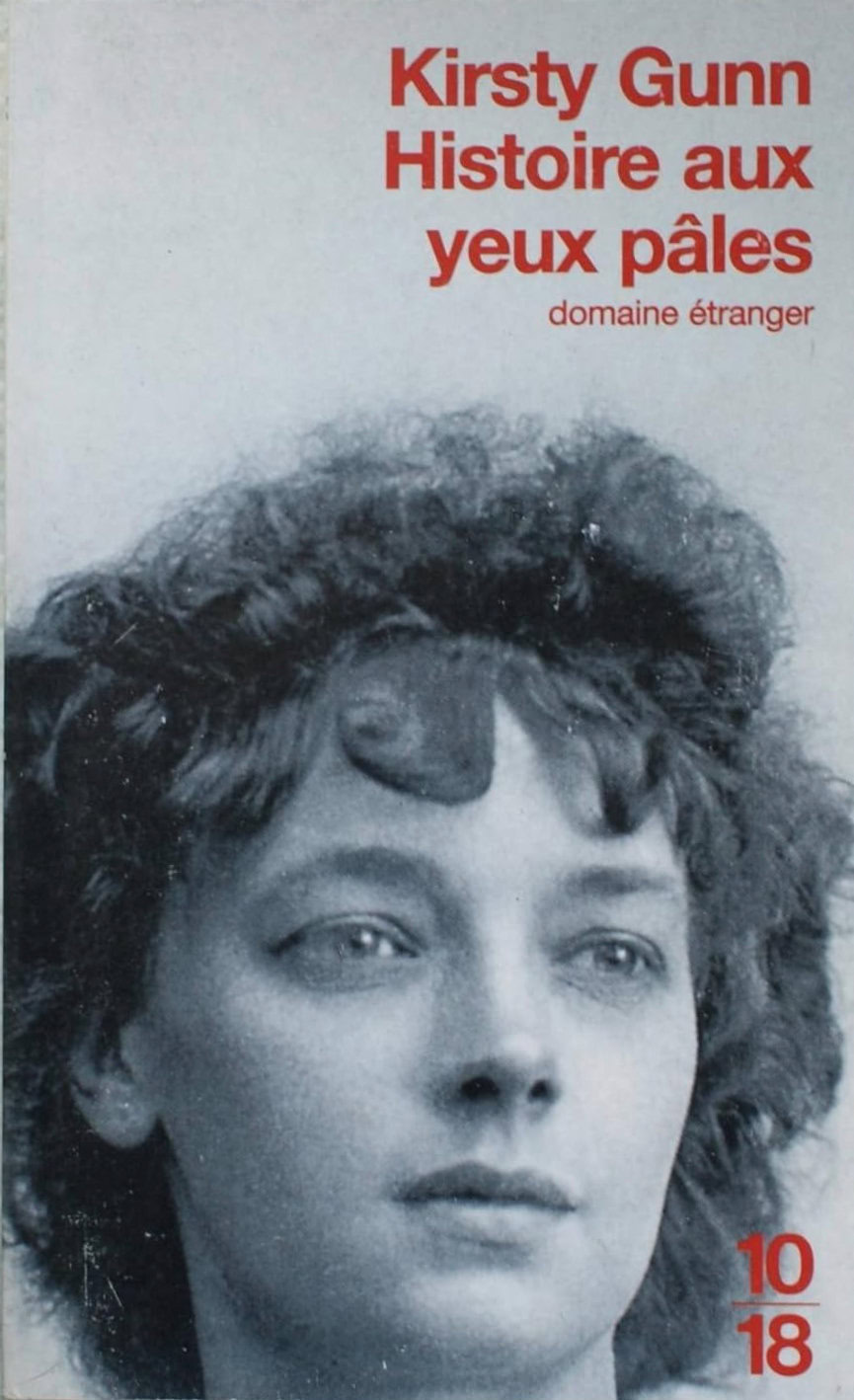 Je la trouve courageuse. Pas seulement dans l’écriture. Je la trouve courageuse dans ses choix, dans les risques qu’elle prend. Dans les possibles qu’elle ouvre — qu’elle a ouverts pour moi : avant elle, j’écrivais mais je n’entendais pas. Il y a eu un déclic avec son écriture. Une voix, le sens du rythme, du moins : d’un rythme plus intime, qui avait à voir avec la langue, plus seulement avec l’écriture. On n’était pas dans l’autofiction, on n’était pas dans la fiction, on n’était pas dans un endroit connu, ni confortable. Mais on était. Face à ses mots. Et les mots eux-mêmes ont commencé à habiter réellement la langue, la mienne y compris : ce n’était plus dire pour raconter, c’était dire pour faire entendre. C’était : appuyer. Que ce soit là où ça fait mal. Ou juste là où c’est nécessaire.
Je la trouve courageuse. Pas seulement dans l’écriture. Je la trouve courageuse dans ses choix, dans les risques qu’elle prend. Dans les possibles qu’elle ouvre — qu’elle a ouverts pour moi : avant elle, j’écrivais mais je n’entendais pas. Il y a eu un déclic avec son écriture. Une voix, le sens du rythme, du moins : d’un rythme plus intime, qui avait à voir avec la langue, plus seulement avec l’écriture. On n’était pas dans l’autofiction, on n’était pas dans la fiction, on n’était pas dans un endroit connu, ni confortable. Mais on était. Face à ses mots. Et les mots eux-mêmes ont commencé à habiter réellement la langue, la mienne y compris : ce n’était plus dire pour raconter, c’était dire pour faire entendre. C’était : appuyer. Que ce soit là où ça fait mal. Ou juste là où c’est nécessaire.
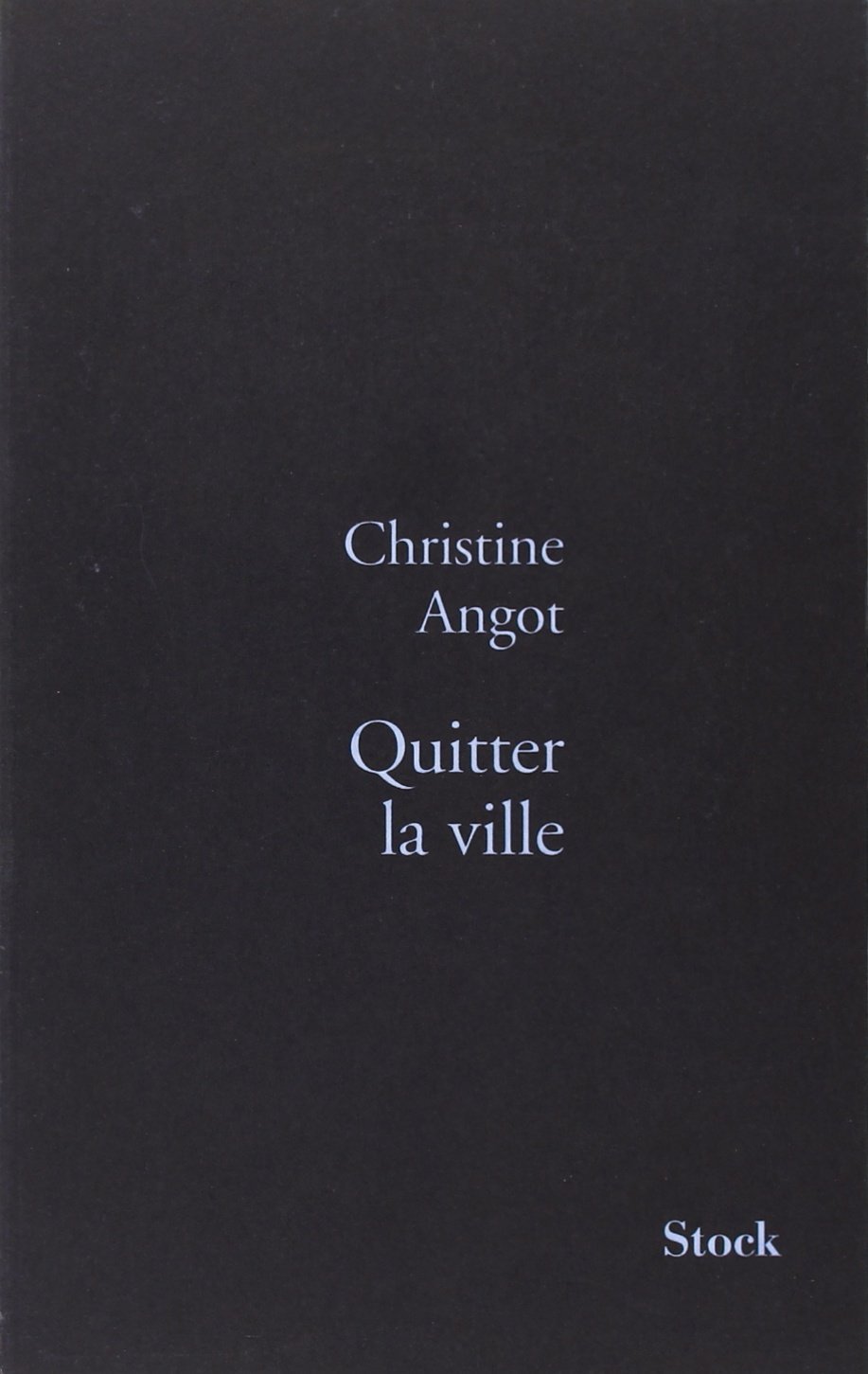 Je la trouve courageuse au quotidien. Je trouve courageux de se coller à la haine des autres. De tenir tête. C’est Antigone. Dans Quitter la ville — référence à Thèbes, évidemment —, il y a cette analogie qu’elle fait entre son nom et le nom de l’héroïne tragique. Christine Angot et Antigone, c’est presque une anagramme. C’est très violent, Quitter la ville. Je crois que c’est le livre que je préfère, d’elle.
Je la trouve courageuse au quotidien. Je trouve courageux de se coller à la haine des autres. De tenir tête. C’est Antigone. Dans Quitter la ville — référence à Thèbes, évidemment —, il y a cette analogie qu’elle fait entre son nom et le nom de l’héroïne tragique. Christine Angot et Antigone, c’est presque une anagramme. C’est très violent, Quitter la ville. Je crois que c’est le livre que je préfère, d’elle.
Et puis, c’est personnel : je trouve qu’elle a un visage rare. Et un sourire incroyable.
As-tu des rituels d’écriture, au fait ?
Je ne crois pas. Je crois que j’ai essayé d’en avoir, parce que je me disais que ça allait avec la pose. Avant. Et puis je me suis rendu à l’évidence: sur ma chaise que j’aime, à mon bureau que j’aime, je suis certains jours à ma place, confortablement installé, et certains autres, horriblement mal, absolument dévasté, par la position, ce que j’ai en face de moi, ce que je ressens, à ce moment-là, précis.
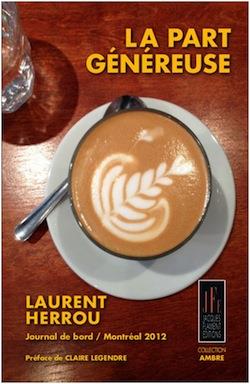 Et que ce soit confortable ou non, l’écriture reste, elle tient, elle serre les dents, elle mord, elle hurle — et je hurle avec. Il m’arrive de me verser un thé dans une théière que j’adore pour accompagner l’écriture, et généralement, la théière reste intouchée tout au long de l’écriture, et lorsque je me rends compte de sa présence, le thé est froid. Ça ne marche pas, les rituels, avec moi : je crois qu’on se les crée quand on a peur d’écrire.
Et que ce soit confortable ou non, l’écriture reste, elle tient, elle serre les dents, elle mord, elle hurle — et je hurle avec. Il m’arrive de me verser un thé dans une théière que j’adore pour accompagner l’écriture, et généralement, la théière reste intouchée tout au long de l’écriture, et lorsque je me rends compte de sa présence, le thé est froid. Ça ne marche pas, les rituels, avec moi : je crois qu’on se les crée quand on a peur d’écrire.
Tu as été à plusieurs reprises en résidences d’écriture, si je ne m’abuse (Passa Porta à Bruxelles en 2009, Le Diable Vauvert la même année, L’Atelier Expérimental, dans les Alpes Maritimes, en 2007, et des résidences virtuelles comme Le labo de Jacques Flament, ou les Déboîtements de Christophe Grossi). Quel regard portes-tu sur ce travail en huis clos ?
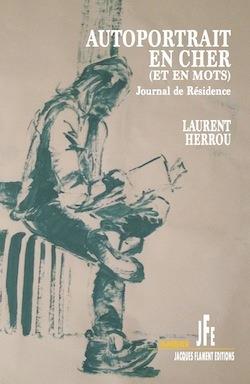 J’aime cet arrachement à soi. On s’oblige à quitter les lieux que l’on connaît (et pour certains, ses rituels justement) pour se confronter à l’inconnu. On ne sait rien, ou peu, du lieu qui accueille, des conditions de travail, des conditions de vie tout simplement. C’est un peu quitte ou double, on va être bien ou pas, ou encore, dans mon cas : on va être bien un jour sur deux, sans logique. Dans Je suis un écrivain, qui raconte la résidence à l’Atelier Expérimental d’Isabelle Sordage, à Clans, je raconte combien je suis terrifié la nuit. Alors que c’est un village, alors qu’il n’y a pas spontanément de danger proche, identifiable. Ça a forcé des choses, en moi, à la fois dans la personne que je suis et dans l’écriture. C’est à Clans que j’ai trouvé ma voix, orale, c’est à Clans pour la première fois que mes lectures publiques ont passé le cap du spectateur, que ma voix a commencé à être entendue. Probablement parce que j’avais tellement peur qu’il fallait que j’occupe le terrain autrement. Pour moi, cette résidence-là a été un révélateur. Du potentiel — et cela, bien au-delà de l’écriture.
J’aime cet arrachement à soi. On s’oblige à quitter les lieux que l’on connaît (et pour certains, ses rituels justement) pour se confronter à l’inconnu. On ne sait rien, ou peu, du lieu qui accueille, des conditions de travail, des conditions de vie tout simplement. C’est un peu quitte ou double, on va être bien ou pas, ou encore, dans mon cas : on va être bien un jour sur deux, sans logique. Dans Je suis un écrivain, qui raconte la résidence à l’Atelier Expérimental d’Isabelle Sordage, à Clans, je raconte combien je suis terrifié la nuit. Alors que c’est un village, alors qu’il n’y a pas spontanément de danger proche, identifiable. Ça a forcé des choses, en moi, à la fois dans la personne que je suis et dans l’écriture. C’est à Clans que j’ai trouvé ma voix, orale, c’est à Clans pour la première fois que mes lectures publiques ont passé le cap du spectateur, que ma voix a commencé à être entendue. Probablement parce que j’avais tellement peur qu’il fallait que j’occupe le terrain autrement. Pour moi, cette résidence-là a été un révélateur. Du potentiel — et cela, bien au-delà de l’écriture.
Passa Porta m’a permis de rencontrer à la fois Bruxelles et Pascale Fonteneau. Ce n’est pas un hasard si je vis aujourd’hui à Bruxelles. Et si nous sommes devenus amis, Pascale et moi.
Et tu as lancé ce projet très particulier qu’est Public averti et que je trouve passionnant. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet, sur les artistes concernés (un groupe libre d’artistes, un groupe d’artistes libres…), le site, vos expositions et vos lectures publiques ?
Pauline Sauveur, qui est auteure et photographe, a été invitée à exposer à la Charité sur Loire pendant le Festival du Mot 2015. Elle avait envie de faire une lecture en parallèle, elle savait que je lisais moi aussi, elle m’a proposé de la rejoindre sur l’événement. Parce que notre travail était adulte (pour elle, Presqu’il-e, qui suivait la transformation d’une femme en homme, pour moi Le Bunker, qui est un exercice schizophrène sur l’enfermement — les deux publiés par Jacques Flament), nous avions spécifié sur l’affiche en référence au mot « lectures » : * Public Averti.
Le nom est resté — et l’astérisque — et nous avons eu l’idée d’organiser d’autres événements : des lectures (la série Klaxon, dont les premiers rendez-vous avaient lieu à Sancerre, et les deux derniers chez Eléments de langage, à Bruxelles) ; et des expositions d’art contemporain.

Je résidais alors au Château de Villequiers, qui était un terrain admirable pour faire découvrir le travail d’artistes de toutes disciplines à un public qui a très peu accès à la culture. Les deux premières éditions ont eu beaucoup de succès. Parce que j’ai dû quitter le château pour raisons familiales, la dernière édition (Printemps et Automne 2017) s’est cherchée un nouveau lieu de vie. Nous avons rencontré l’éditeur transdisciplinaire Conspiration (Paris) qui a été sensible à notre démarche et nous a ouvert les portes de son site pour faire des expositions virtuelles. Mais pour l’Automne 2017, qui regroupe sept artistes (Michel Barrière, Alexandra Guillot, Christine Guinard, Nicolas Landemard, Vincent Labaye, Camille Rocailleux et Pauline Sauveur), nous avons voulu que le virtuel se double de micro-événements réels, et nous avons ainsi créé des Expositions Ephémères : l’une d’elles a eu lieu à Bruxelles, chez Eléments de langage (que l’on adore), le 17 novembre dernier, à la fois projections vidéo et photo des artistes, mais aussi lectures performatives.
Peux-tu nous en dire plus aussi sur ce texte qui sera publié chez EDL au printemps 2018 ? Il paraît que ça parle de la Fnac (résumé plus que concis !), je serais curieuse d’en apprendre davantage…
 Quand je te disais que j’adore Eléments de langage (EDL) ! Nicolas de Mar-Vivo, son directeur, publie ce qu’il appelle des O.L.N.I., des Objets Littéraires Non-Identifiés. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j’ai tout de suite pensé qu’il pourrait être intéressé par le texte en question, qui s’intitule Le petit mot. J’ai travaillé à la Fnac de Nice pendant huit ans. Pendant huit ans, ce petit mot, « Fnac », a été très présent dans mon journal. Que ce soit pour le travail que j’y accomplissais, les rencontres que j’y faisais, les énervements, le plaisir de vivre auprès de mes premiers livres (j’étais libraire) etc.… J’ai recensé toutes les phrases de mon journal qui contenaient ce petit mot, je les ai mises bout à bout et je me suis demandé ce que ça donnerait.
Quand je te disais que j’adore Eléments de langage (EDL) ! Nicolas de Mar-Vivo, son directeur, publie ce qu’il appelle des O.L.N.I., des Objets Littéraires Non-Identifiés. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j’ai tout de suite pensé qu’il pourrait être intéressé par le texte en question, qui s’intitule Le petit mot. J’ai travaillé à la Fnac de Nice pendant huit ans. Pendant huit ans, ce petit mot, « Fnac », a été très présent dans mon journal. Que ce soit pour le travail que j’y accomplissais, les rencontres que j’y faisais, les énervements, le plaisir de vivre auprès de mes premiers livres (j’étais libraire) etc.… J’ai recensé toutes les phrases de mon journal qui contenaient ce petit mot, je les ai mises bout à bout et je me suis demandé ce que ça donnerait.
J’espère que les lecteurs se le demanderont aussi.
C’est en tout cas un texte parfait pour une mise à l’oral, et je compte bien m’y coller.
Laurent, pourquoi écris-tu ?
 Lorsque nous nous sommes rencontrés, chère Edith, à cette question, je crois que j’ai répondu que c’était une manière de mourir avant l’heure, de devancer l’appel. Ou plutôt d’avoir cette chance d’être à la fois dans la vie au quotidien et dans le récit a posteriori de cette vie-là, souvent au passé (mais pas exclusivement), en la regardant avec une distance étrange, un peu comme la désincarnation qui accompagne, dit-on, les Near Death Experiences, lorsque des patients sont dans le coma, par exemple.
Lorsque nous nous sommes rencontrés, chère Edith, à cette question, je crois que j’ai répondu que c’était une manière de mourir avant l’heure, de devancer l’appel. Ou plutôt d’avoir cette chance d’être à la fois dans la vie au quotidien et dans le récit a posteriori de cette vie-là, souvent au passé (mais pas exclusivement), en la regardant avec une distance étrange, un peu comme la désincarnation qui accompagne, dit-on, les Near Death Experiences, lorsque des patients sont dans le coma, par exemple.

C’est une chance, mais c’est aussi une malédiction.
On sait des choses, que la plupart des gens ignorent. C’est Cassandre, si tu veux.
J’ai toujours pensé que la tragédie grecque était une illustration parfaite de l’existence. J’ai été fasciné par cela très tôt. Probablement que j’ai eu envie, en écrivant, de construire ma propre tragédie.
Un commentaire